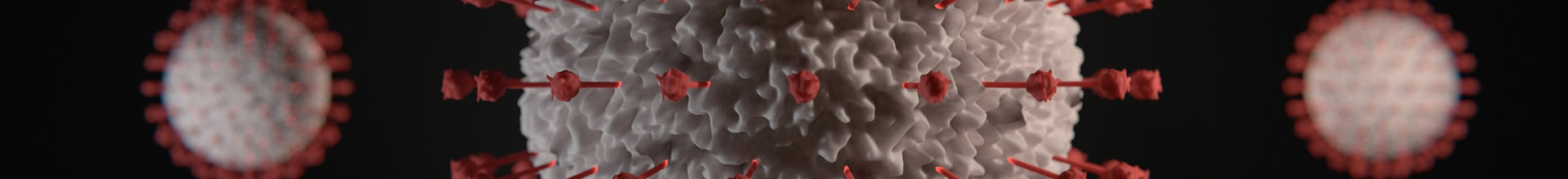8th June 2020
Directeur de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Unistra/CNRS/Inserm), Université de Strasbourg

La Covid-19 a mis en évidence une forte inadéquation des rapports entre science et politique. Certes, la voix des scientifiques est mieux entendue, notre gouvernement, nos concitoyens ont manifesté de l’écoute, même du respect pour leurs avis. Mais le « discours polyphonique » des chercheurs a aussi engendré des incompréhensions dues à la méconnaissance des processus qui président à la science.
Un rapport biaisé et incomplet entre science et politique
Cette méconnaissance est hélas aussi présente chez ceux qui nous gouvernent. Beaucoup d’entre eux n’ont pas une culture scientifique, dans une administration structurée autour des diplômés des grandes écoles, avec très peu de titulaires du doctorat à des postes-clés. Même si nous n’avons jamais eu autant de ministres titulaires d’un doctorat, en 2019 seules trois places sur 173 étaient ouvertes aux docteurs au concours de l’ENA.
Cette ignorance culturelle des principes de base du débat scientifique ne permet pas au politique de poser les bonnes questions aux experts, ou de comprendre leurs réponses. On se contente en fait d’un « attelage de fortune » entre le scientifique et le politique qui se fera au détriment de l’un comme de l’autre, et donc de la société. L’élu va demander aux experts des preuves certaines, une parole unique, alors qu’ils ne pourront fournir qu’un état de l’art « polyphonique », que le politique a du mal à interpréter. Car l’expert ne peut, ni ne doit, dicter la décision elle-même.
Certains avancent que, parce que cette culture scientifique permanente était déficitaire, le gouvernement n’avait, au début de la pandémie, que des informations disponibles publiquement et pas nécessairement complètes. Il a fallu attendre la constitution tardive de comités ad hoc pour que l’avis scientifique soit disponible pour les décideurs. Or les situations d’urgence mettent la relation entre la science et la politique sous forte pression. Elles demandent une réaction rapide, tout en préservant la précision des données et la confiance, alors que la science se construit sur le temps long. Pour une réponse rapide et efficace dans ces situations d’urgence, il faut avoir mis en place, sur le long terme, des mécanismes résilients basés sur une relation pérenne et efficiente entre science et politique.
Reconstruire la chaîne qui va de l’avis scientifique à la décision politique
Ce n’est pas d’expertise dont nous avons manqué ; la France est un pays qui possède des experts de niveau mondial pour faire face à la Covid-19. Mais, dans cette chaîne qui va de la science à la décision politique, il y a des maillons faibles et des chaînons manquants.
Le maillon faible est du côté de l’intégration de la science par le politique. Il n’est pas question de juste « suivre la science », car on éluciderait alors les questions de responsabilité politique.
Le chaînon manquant, c’est le « conseiller scientifique », qui existe dans de nombreux pays (États-Unis, Malaisie, etc.). Ce n’est pas le conseil scientifique monté dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et formé d’experts incontestables, mais dont la mise en œuvre fut tardive, le 11 mars 2020.
Ce qui a manqué, c’est un rapport continu avec la science, c’est une familiarité permanente du décideur avec les concepts et les outils de la science. Faute de cette familiarité, on risque de voir le conseil scientifique quitter son rôle de conseil pour un rôle de décideur, voire d’alibi. Ainsi après avoir martelé que les masques devaient être réservés aux soignants et aux malades, les jugeant inutiles voire « contre-productifs » sur les personnes non infectées, l’exécutif fait volte-face début avril, en « encourageant » le port des masques pour l’ensemble de la population. Pour se justifier, le gouvernement a invoqué l’absence de consensus chez les scientifiques, alors qu’on aurait pu dire, en toute transparence, que cette décision était motivée stratégiquement par des stocks limités.
Pour assurer la transmission raisonnée de l’expertise, il faut donc placer auprès du décideur un conseiller scientifique, qui sollicitera et traduira les avis des experts, afin de permettre à l’élu de prendre ensuite, en pleine responsabilité, sa décision.
L’avis scientifique est plus important en période normale qu’en période de crise
Pourquoi ce déséquilibre entre une science presque trop présente en période de crise, et la quasi-absence de recours à un avis scientifique dans la construction de la décision publique au quotidien ?
Certes nous avons l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), les académies, ou le défunt conseil stratégique de la recherche, dont les poids politiques sont limités. Consultés d’une manière épisodique, ou travaillant en auto-saisine, leurs avis ne font pas toujours l’objet d’une exploitation rationnelle.
Nous ne possédons pas une structure collégiale d’expertise scientifique indépendante, comme l’Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) allemande, formée de six experts seulement, et qui remet chaque année à la Chancelière un rapport sur les grandes évolutions de la recherche, de l’innovation et de la technologie.
À côté de ces structures collégiales, il y a les conseillers auprès du gouvernement, comme le conseiller scientifique du président des États-Unis ou les conseillers scientifiques des Premiers ministres de très nombreux pays par exemple le Royaume-Uni, le Québec, la Malaisie ou l’Inde. C’est ce type de position que je suggère de créer en France, sur la base de ces quelques fondamentaux.
La fonction de conseiller scientifique n’existe pas dans la structure politique française actuelle
Le conseiller scientifique ne supervise pas l’activité de recherche. Son rôle n’est donc pas celui qu’on connaît en France des « conseillers recherche » du Président de la République ou du Premier ministre qui sont différents, à la fois dans leur spectre (ils ont un portefeuille très large) et leur rôle (membres de l’équipe exécutive, ils participent aux arbitrages et aux décisions politiques). Le conseiller scientifique ne prend pas des décisions, il transmet seulement des avis.

Brendon O’Hagan/Flickr, CC BY-NC-ND
Peter Gluckman, ancien conseiller du premier ministre néo-zélandais, utilise pour caractériser cette transmission le terme de « courtage de preuves » (evidence brokerage). Ce rôle de « courtier » consiste à recueillir chez les experts les éléments de preuve et à les transmettre sous forme d’« options cohérentes et acceptables », de manière à ce qu’elles soient comprises et intégrées, tout en identifiant et expliquant les incertitudes. Ce sont donc des transmetteurs, des traducteurs qui doivent avoir la confiance, aussi bien du public que des décideurs, mais sans faire partie du processus politique.
Le conseiller n’est pas un expert disciplinaire
Il propose une méthode plus qu’il ne vulgarise des connaissances. Comme le disait Carlos Moedas « Il ne suffit pas de fournir les preuves. Les conseillers scientifiques doivent expliquer le processus ».
L’avis scientifique ne doit pas se limiter aux sciences expérimentales ou aux nouvelles technologies, et le conseiller scientifique peut être aussi bien un historien qu’un physicien. Il n’est pas un expert, il organise une stratégie d’avis sur des sujets qui ne seront pratiquement jamais dans son champ direct de compétence. Il n’est pas là pour apporter les réponses, mais pour poser les bonnes questions.
L’appui de la science aux politiques publiques ne se limite pas aux ministères « scientifiques »
Justice, transport, éducation, économie, etc. peuvent aussi avoir leur conseiller scientifique, alors que ce ne sont pas des ministères qui ont un rapport direct avec la science. Ainsi existe souvent un conseiller scientifique du ministre chargé des affaires étrangères, alors que la relation entre science et diplomatie semblerait peu évidente. Il conseille le ministre sur ce qu’on appelle la diplomatie scientifique. Lors de cette crise, les différents pays n’ont hélas pas semblé apprendre beaucoup les uns des autres ; la diplomatie scientifique aurait probablement été une arme redoutable contre une pandémie sans frontières.
Le conseiller scientifique doit avoir une relation de confiance avec le politique
Selon Peter Gluckman, il s’agit d’un changement de culture ; cette meilleure utilisation des données scientifiques au sein du gouvernement repose sur un niveau de confiance élevé, qui s’appuie avant tout sur des relations individuelles. Cette confiance ne peut être gagnée et maintenue que si le conseiller agit comme un passeur de connaissances, mais jamais comme un « lobbyiste », défendant une position partisane. Ce que dit bien Yves Bréchet : « Il est impératif que le tenant du poste conjugue un devoir de réserve et un devoir de franchise absolue ».
Puisqu’on parle de science, avons-nous la preuve expérimentale que les pays dotés d’un tel système ont mieux géré la crise ?
Bien sûr, il n’y a pas de relation univoque de cause à effet ; la présence du conseiller scientifique ne peut à elle seule expliquer le succès ou l’échec d’une politique.
Comparons le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, qui ont des dispositifs similaires : un conseiller scientifique du Premier ministre qui s’appuie sur un réseau de conseillers des ministères. La perception du rôle de la science dans la gestion de la pandémie a été très bonne en Nouvelle Zélande, et la Première ministre néo-zélandaise pourrait « donner une master class en gestion de crise ». Par contre l’utilisation des avis scientifiques par Boris Johnson lors de cette crise est l’objet de très nombreuses critiques. De même, il n’y a pas de différence nette dans les statistiques épidémiologiques entre le Royaume-Uni et la France, qui est dépourvue d’un tel système de conseillers scientifiques.
Évitons donc de trop simplifier la relation entre la science et la politique. Proposer un conseiller scientifique ne vise pas à prétendre que la science peut résoudre tous les problèmes. Un conseiller scientifique sera une condition probablement nécessaire mais certainement pas suffisante pour une gouvernance éclairée et responsable, et en tout cas pas une garantie de résultat. Car c’est le politique, élu par nos concitoyens, qui aura, heureusement le dernier mot.![]()
Alain Beretz, Directeur de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Unistra/CNRS/Inserm), Université de Strasbourg
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.
Link to full article